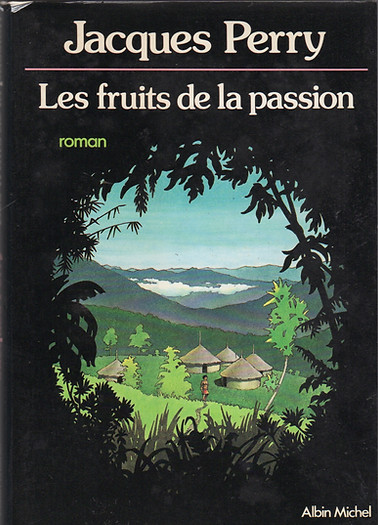

Les Fruits de la passion
Albin Michel, 1977.
« …Écrit avec ce ton ingénu et tendre de l’homme qui débarque et que tout étonne, Jacques Perry nous raconte l’expérience du dépaysement chez un homme qui, en quelques jours, va changer ses habitudes, sa sensibilité, son système du monde. C’est un très beau livre et très bien fait.
Insensiblement, Philip Saint-Paul, homme vieillissant, bien renté et très affairé, va se convertir à la vie naturelle. Nous allons assister, dans un des plus beaux endroits du monde, en Nouvelle-Guinée, à l’éveil de ses perceptions et de ses idées, à un fonctionnement renouvelé des désirs grâce à une partenaire papoue, Aema, qui est elle-même, comme dans les religions de la génération plus que la femme. Elle est la féminité, la nature ou au moins un lien vital, une forme, une fonction qui assure par la vie des sens une adaptation totale, parfaite avec le vaste monde.
Si vous voulez bien profiter de vos vacances, emportez ce livre. Vous lirez une fable plaisante totalement inventée et donc capable de vaincre les routines de la vie et toutes les formes d’ordre à quoi vous êtes soumis habituellement et qu’il va falloir oublier. De plus, en été, il n’est pas meilleur guide qu’une poète amoureux.
Jacques Perry s’est coulé dans son personnage. Il le suit comme son ombre. Il s’ébroue avec lui et vous apprend à ramasser des coquillages, à prendre une pierre et à la lancer, à jouer avec votre corps et votre visage, en un mot à devenir un bon sauvage… »
Pierre Sipriot, Le Figaro
« …Jacques Perry obéit davantage à son caprice, à son invention d’écrivain, et à une sorte de vue équilibrée des choses. Il ne prétend pas qu’Aima, la primitive, ni que Saint-Paul, le civilisé, détiennent la vérité de l’existence. Tout le processus du récit tend à montrer, me semble-t-il leur façon de se compléter et de se rejoindre. Emmenée dans la belle maison de Port-Moresby, la jeune Noire s’étonne de tout ce qu’elle voit, admire ou rejette maints objets mystérieux pour elle ou apparemment inutiles - tel le grand tube ronfleur qui avale toutes les poussières. Elle demeure fidèle à elle-même mais elle s’adapte aussi avec vivacité….
Le civilisé blasé et disponible s’émerveille des dons naturels de sa protégée. A vrai dire, c’est elle qui va lui enseigner les secrets qu’elle porte en elle, dans son corps, ses gestes, son sourire, ses craintes, une science aussi riche et féconde que celle dont il est l’héritier trop conscient. Mais Jacques Perry ne pousse pas cependant le renversement jusqu’à faire renier par son héros sa propre culture au seul bénéfice de celle d’Aema. S’il la délivre de quelques superstitions et de sa peur des sorciers, il s’efforce de ne rien détruire en elle mais de l’introduire dans un monde nouveau qu’elle remet en question par sa seule présence et où elle trouvera finalement sa place et sa rôle. Saint-Paul ne subit pas une métamorphose comparable à celle de Robinson dans le roman de Michel Tournier: Vendredi ou les limbes du Pacifique. Robinson s’identifie aux grandes forces élémentaires dévoilées par Vendredi tandis que le personnage de Jacques Perry subit une mue intérieure en découvrant une femme qui le libère de ses fantasmes égoïstes et narcissiques… »
George Anex
« …Aema apprenait beaucoup de mots tous les jours : les mots de la vie et les mots de la tête. Quand elle voulait savoir le nom d’un objet, elle posait le doigt dessus et Saint-Paul donnait le mot anglais qui le désignait. Si le même objet avait une appellation en pidgin, il la lui indiquait aussi mais pour lui en montrer le côté enfantin, répétitif et bêtifiant. Il ne supportait pas que patate douce se dît kau-kau et canne à sucre pit-pit. Il voulait dépidginiser peu à peu le langage d’Aema. En même temps, elle lui apprenait le mot sinandu quand il existait. Ils allaient ainsi à la rencontre l’un de l’autre. Quant aux mots abstraits qu’elle appelait les mots de la tête, elle ne pouvait les montrer et tentait de les faire comprendre ou de se les faire expliquer par le détour des images.
L’idée de travail la tourmentait depuis que les domestiques blancs de Sinpol lui disaient pour ne pas répondre à une question qu’elle leur posait : « Mademoiselle m’excusera, j’ai mon travail. » Quel travail? Nicholas apportait les plats sur la table pour leur faire partager ce que la cuisinière avait préparé : ce n’était pas du travail. Et parler à ce qu’ils appelaient téléphone, ouvrir la porte : pas du travail. Sibyl, la femme de chambre, tirait sur les draps, chassait la poussière et, qui sait? un petit débris de peau avec le plat de la main : pas du travail. (Aema avait bien observé qu’elle recueillait toutes les poussières intimes dans une pelle qu’elle vidait dans une grande boîte portée tous les soirs dans la rue - quelle folie! - mais toutes les maisons s’ouvraient le soir pour abandonner les mêmes boîtes qu’un aide-sorcier passait vider à l’aube dans un grand camion.) La femme de chambre était aussi femme de couloir puisqu’elle y promenait un grand tube ronfleur qui avalait tout. Aema ne pouvait considérer l’aspirateur comme un outil de travail ; c’était l’image même de la voracité. Les plumes blanches échappées de l’oreiller su ruaient dans sa bouche avide. Tapoter les lits, essuyer les images Tamberan pendues au mur - ce qui était normalement interdit aux femmes - pousser le grand dévorateur : pas du travail. La femme qui faisait la cuisine sous la terre ne travaillait pas. Elle s’amusait à courir les rues le matin, à ramener des paniers de toutes les couleurs, à couper en lanières, morceaux, portions, tranches, trognons, brins, julienne (Aema apprenait tous ces mots) et rogatons et rognures qu’on jetait aux chats; à larder, piquer, ficeler, braiser, bouillir, griller; et surtout à goûter en plongeant et replongeant une grande cuiller de bois dans ce qu’elle appelait sauce. (Attirée par une forte odeur de porc grillé, Aéma était descendue pour la première fois dans la cuisine-cave le lendemain de son arrivée à Victoria Hall; elle s’avançait vers le tertre planté de trois ifs et la petite tranchée remplie de pierres brûlantes, elle allait voir Wuvulu tirer du feu une paire de côtes ruisselantes de graisse… elle vit la cuisinière de beaucoup de chair devant la cuisinière d’émail blanc et d’acier. Elle vit le porc griller en tournant tout seul devant une braise sans bois et elle se sentit un peu défaillir de faim déçue, de crainte devant la grosse dame hautaine).
Aema ne s’étonnait pas qu’aucun des serviteurs de Sinpol ne fût noir ni jaune; il ne lui eût servi à rien de savoir que la cuisinière venait de Sydney et descendait par trois relais d’une prostituée londonienne et d’un convict écossais, que Sibyl, la femme de chambre envoyée par une agence de Melbourne était une émigrante de l’Ulster et que Nicholas, Macédonien, seul survivant d’un yacht grec brisé sur un récif avancé de la Grande Barrière, pensait son nom Nikolaüs, elle s’étonnait que tous ces gens qui en réalité s’amusaient invoquassent leur travail pour ne pas lui répondre.
Elle ne se plaignit pas d’eux mais demanda à Saint-Paul pourquoi les gens qui s’amusaient prétendaient travailler.
- Le travail, c’est quoi pour toi? lui demanda Saint-Paul.
- Travail, dit-elle, c’est fatigue.
Saint-Paul rit beaucoup puis il eut un doute et chercha la définition de work. Il lut: gêne, fatigue, peine qu’on prend pour faire quelque chose. Poussant plus loin ses recherches, il s’enquit de l’origine du mot français travail et découvrit qu’il dérivait du latin populaire tripaliare qui voulait dire tourmenter avec le tripalium. Pour tripalium, le dictionnaire latin donna instrument de torture, et, plus spécialement, machine à trois pieux utilisée pour ferrer les cheveux sans danger.
- Tu as raison, lui dit-il alors, Nicholas et les autres s’amusent. Comme je les paye pour qu’ils s’amusent, ils appellent ça du travail. Tu n’as jamais travaillé, Aema?
- Jamais travaillé.
- Wuvulu ton père chasse et ses femmes fatiguent, tourmentent - je veux dire travaillent - le jardin en s’amusant. Et moi je travaille?
- Non! Dans bureau assis à table, papier dans main, œil sur papier, œil en l’air, regarde loin, pas travail.
- A ton avis, lui demanda Saint-Paul, pourquoi les hommes travaillent-péniblement au lieu de chasser-jardiner-agréablement?
Elle ne savait pas.
- Ton père chasse, tue et mange tous les cochons qu’il rencontre, dit Saint-Paul. Il n’en reste pas assez pour les autres; alors ils sont obligés de travailler pour avoir assez à manger.
- Mon père comme Sinpol. Victoria grande maison, les autres rien. Pour avoir, travaillent.
- Tout le monde peut avoir plu : il faut couper les forêts, assécher les marais, défricher.
- Non, dit-elle, manger peu, s’amuser… »
(p.125-129)